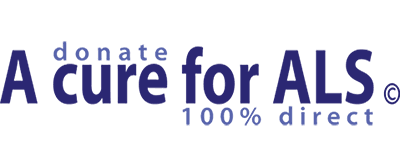Débat sur l'euthanasie en Belgique : le poids invisible des soignants
11-04-2025
"Ce qui est souvent absent du débat public, c'est le point de vue de ceux qui accompagnent une personne dans le processus d'euthanasie."

En 2024, près de 4 000 personnes en Belgique ont opté pour l'euthanasie, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Les partisans de cette législation la présentent comme un paradigme de compassion et d'autonomie personnelle. Cependant, les critiques mettent en garde contre une désensibilisation croissante à la mort et une baisse subtile de la qualité des soins. Pris au milieu, les patients, les familles et les médecins doivent non seulement faire face au chagrin et à la douleur, mais aussi à un processus de plus en plus médical et routinier.
Le 13 février 2015, Christiane, une femme âgée de 80 ans, se préparait pour un événement mémorable. Ses deux filles étaient présentes, le médecin de famille avait été prévenu et, dans l'agenda à côté de son lit, elle avait inscrit la date avec les mots : "Le grand jour".
Christiane avait été diagnostiquée avec une forme rare de sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie du motoneurone (MND). Comme sa capacité à parler, à avaler et à respirer se détériorait, sa condition physique déclinait; néanmoins, elle disposait d'une dernière prérogative en Belgique : le droit légal de décider du moment de sa mort.
En 2002, la Belgique est devenue le deuxième pays au monde à légaliser l'euthanasie, après les Pays-Bas. Depuis sa promulgation, la loi belge sur l'euthanasie est qualifiée comme l'une des plus libérales et controversées au monde. Cette loi autorise les professionnels de santé à administrer des médicaments mettant fin à la vie des patients endurant des souffrances physiques ou psychologiques "insupportables" résultant d'une maladie grave et incurable.
En 2024, 3991 cas d'euthanasie ont été officiellement enregistrés, soit une augmentation de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Par conséquent, l'euthanasie représente désormais 3,6 % de tous les décès en Belgique. La majorité des patients ont plus de 70 ans, dont 54 % diagnostiqués avec un cancer et 26,8 % souffrent de multipathologies chroniques. Les cas attribués à de la souffrance psychologique représentent 1,4 %.
La majorité des procédures d'euthanasie se déroulent à domicile (50,4 %) ou à l'hôpital (30,2 %), dont 6,3 % dans des unités de soins palliatifs. Fait notable, un seul cas en 2024 concernait un mineur, une disposition qui est autorisée depuis qu'un amendement controversé à la loi a été introduit en 2014. Cette évolution porte à six le nombre total de cas impliquant des mineurs au cours de la dernière décennie.
L'augmentation des cas d'euthanasie a suscité à la fois de l'inquiétude et du soutien au sein de la communauté. Pour certaines personnes, comme Catherine Rombouts, la fille de Christiane, l'euthanasie est perçue comme un choix personnel et empreint de compassion. À l'inverse, elle soulève des inquiétudes quant à l'évolution des limites entre soins et contrôle pour les autres.
Le point de vue d'une fille
"Elle ne souhaitait pas être un fardeau", a déclaré Catherine Rombouts. "Elle avait toujours attaché de l'importance à son indépendance et à sa dignité. Ce choix était parfaitement cohérent avec sa personnalité. "

Christiane, la mère de Catherine Rombouts.
Christiane s'est éteinte paisiblement, en présence des proches qui lui étaient chers, après une brève intervention médicale. Un médecin a inséré un cathéter et administré un barbiturique (thiopental), entraînant son décès en quelques minutes. "Elle n'a pas souffert", a déclaré C. Rombouts. "Il n'y avait ni peur ni panique. Ce fut un départ serein. C'était exactement ce qu'elle souhaitait. "
Cette expérience a incité C. Rombouts à coécrire Le grand jour, un livre photographique documentant les derniers jours de sa mère, en collaboration avec l'historienne Sophie Richelle. Au-delà de constituer un hommage personnel, le livre est apparu comme un témoignage significatif concernant la manière dont les familles belges vivent et commémorent l'euthanasie.
"Ce qui est souvent absent du discours public, c'est le point de vue de ceux qui accompagnent une personne à travers le processus d'euthanasie", a fait remarquer C. Rombouts. "Ce récit n'est pas seulement l'histoire de notre mère, c'est aussi fondamentalement la nôtre."
L'évolution du scénario social de la mort
Historiquement, l'expérience de la mort était un événement prolongé et communautaire au cours duquel les familles se réunissaient et partageaient les soins collectivement. Le processus de la mort était souvent marqué par l'incertitude et la progression graduelle. Cependant, avec l'introduction de l'euthanasie, cette expérience est caractérisée par une formalité bureaucratique, définie par une date, une heure et un plan prédéterminés, modifiant ainsi la compréhension traditionnelle du processus de la mort.
Cette transition modifie fondamentalement le rôle des soignants qui accompagnent les personnes dans leurs derniers instants. Lorsque la mort est programmée, les soignants doivent s'adapter, à la fois émotionnellement et pratiquement.
"Les dix jours entre le choix de la date et l'acte lui-même ont été compliqués : soudain, il y avait un compte à rebours. Et ce compte à rebours a été difficile. Parce qu'à plusieurs reprises, elle m'a appelée pour me dire qu'elle voulait que ce soit terminé", a ajouté Catherine.
L'ambiguïté, associée au fait de ne pas savoir quand le moment de la mort surviendra, a traditionnellement fait partie intégrante des soins de fin de vie. Tandis que, dans le contexte de l'euthanasie, les soignants préparent désormais les adieux avec une précision clinique.
Le Dr Yves De Locht, médecin bruxellois, a pratiqué des dizaines de procédures d'euthanasie depuis 2008. Il a admis qu'il lui avait fallu "des années avant d'oser pratiquer [sa] première euthanasie." Son tout premier patient, se souvient-il, était un prêtre catholique. Il m'a dit : "Ma santé est une chose, mes convictions en sont une autre", a-t-il déclaré.
"Il souffrait. Il voulait mourir dans la dignité. C'est la chose la plus difficile émotionnellement que je fasse en tant que médecin. Mais aussi, peut-être, la plus significative. Lorsque je quitte la pièce, j'ai souvent le sentiment d'avoir aidé quelqu'un à échapper à une souffrance que personne d'autre ne pouvait soulager", a-t-il ajouté.

Yves de Locht pratique, depuis 15 ans, des procédures d'euthanasie en Belgique. Il livre aujourd'hui son témoignage dans un ouvrage publié en France. Crédit photo : Mathieu Golinvaux
Un rapport récent du MCC Bruxelles, un groupe de réflexion conservateur, présente toutefois une perspective dissidente sur l'euthanasie, suggérant que cette pratique ne renforcerait pas l'autonomie du patient comme le prétendent ses partisans. Au contraire, il soulève des inquiétudes quant à l'expansion potentielle de l'autorité de l'État et de la médecine sur les questions de vie et de mort.
Le rapport critique la "bureaucratisation croissante de la mort" et la prévalence d'une terminologie vague telle que "mourir dans la dignité." Il postule que la légalisation de l'euthanasie a entraîné une pression excessive sur les populations de patients vulnérables, un flou des distinctions éthiques et une désensibilisation croissante de la valeur intrinsèque de la vie humaine.
Le rapport met en lumière l'évolution au Canada où un décès sur 20 est attribué à l'euthanasie. Ce chiffre s'élève à un sur 14 au Québec. Si les statistiques belges sont comparativement plus faibles, sa réglementation est plus permissive, incluant les patients psychiatriques, les personnes handicapées et les mineurs dans des circonstances spécifiques.
De Locht, un défenseur de l'euthanasie, reconnaît ces critères élargis, mais affirme que le processus d'évaluation en Belgique est à la fois rigoureux et transparent. "Je ne prends pas de décisions de manière isolée", a déclaré De Locht, soulignant la nécessité d'un deuxième, voire d'un troisième avis. Un rapport détaillé de dix pages est soumis à la commission fédérale après chaque cas.
Il reconnaît, néanmoins, les préoccupations actuelles liées à cette question. "La loi protège à la fois le patient et le médecin ; cependant, elle impose indéniablement une responsabilité considérable."
La Belgique connaît actuellement un afflux de demandes, dont beaucoup de patients internationaux, notamment ceux de France. "Nous pouvons refuser les demandes, car nous fonctionnons avec une clause de conscience. Néanmoins, la pression est de plus en plus forte", affirme-t-il. "Parfois, les patients ne répondent pas aux critères légaux et, dans certains cas, nous ne disposons pas de ressources suffisantes. "
Le rapport examine également les initiatives de l'Union européenne visant à normaliser les politiques d'euthanasie, en mettant en garde contre les litiges stratégiques, le lobbying et l'activisme transfrontalier pourraient compromettre la souveraineté nationale. Cette perspective reflète une appréhension croissante parmi les groupes conservateurs. De Locht affirme que les garanties belges sont solides et que les abus sont rares. La loi empêche également l'euthanasie clandestine, une pratique qui continue à persister en France (3000 cas par an, selon De Locht).
"La décision d'interrompre un traitement de prolongation de la vie est distincte de l'euthanasie", a expliqué Frawley. "Refuser les soins n'est pas synonyme d'interruption active de la vie."
Cependant, ces discussions semblent souvent abstraites pour des familles comme celle des Rombouts. "Ma mère a fait son choix", affirme-t-elle. "Elle a affronté la mort avec courage et nous avons eu la chance de résider dans un pays où elle a pu exercer son autonomie. La controverse autour de l'euthanasie découle de son implication dans des thèmes universels : la peur de la souffrance, le poids de la perte et la question de savoir ce qu'est une mort digne.
"Il ne s'agit pas principalement de mettre fin à la vie", souligne De Locht. "Il s'agit plutôt de soulager la douleur de la manière la plus humaine possible, pour le patient et pour les soignants."
Traduction: Viviane
Source: The Brussels Times – auteur Anas El Baye